Réussir sa vie (suite). Une never ending story
Écrit par Vincent le 11/12/2021
Ma précédente chronique sur le sujet de la lessive de Cadiz a déclenché un torrent de réactions. De femmes soit admiratives, soit narquoises, soit les deux en même temps. D’hommes se justifiant du fait qu’ils accomplissaient chaque semaine ce type de tâches ménagères.
Je n’ai su que déduire de celles et ceux - rares- qui ont préféré garder le silence. Tout le monde ne semble pas avoir saisi le deuxième, voire le troisième degré de ce pamphlet, un zeste provocateur, mais reposant sur des faits parfaitement véridiques.
Je vous narre la suite des aventures de Vincent face aux problèmes de lessive. Qui sont révélateurs de bien d’autres choses….
Nous sommes arrivés à la Barbade après 17 jours de traversée. Eh bien, en cours de route, l’on a fait quelques lessives avec l’eau produite par le dessalinisateur lui même alimenté par l’énergie solaire de nos panneaux. Mais pas suffisamment pour faire face à ce que produisent en linge sale six personnes.
Donc, à peine à quai, et pendant que l’on nous sondait les fosses nasales, notre machine à laver tournait à plein régime, alimentées par l’eau du quai où nous étions, l’espace de quelques heures, accueillis.
Mais il en restait encore environ de quoi remplir trois machines.
La tâche m’incombe tout naturellement deux jours après notre arrivée, vu l’expérience passée à Cadix. Et le succès de ce fameux article.
Victor m’avait promis de m’amener dans un shipchandler, je le retrouve au port d’accueil avec deux mégas sacs pleins de linge sale. L’un de ses assistants m’indique alors que dans l’un des baraquements en arrière du ponton il existe deux méga machines à laver.
Je triomphe, je vais rapidement décharger mes deux sacs et demande quelles pièces de monnaies doivent être utilisées pour ces machines. L’on me répond qu’il faut des jetons. Sait-on où peut-on se procurer ces jetons ? Réponse : personne ne le sait.
Après trois téléphones tentés sans suite par les deux assistants locaux de Victor, l’on m’envoie dans le building flambant neuf qui abrite le port authority.
L’on me fait entrer dans un local quasi réfrigéré, tant les locaux sont climatisés. Et personne ne sait où l’on peut trouver des jetons des machines à laver de la marina, dont personne n’a apparemment jamais entendu parler.
Un officiel assez senior vient me voir au Rez de chaussée. Il fait interpeller le responsable de la « marina » ( il n’y a qu’un ponton) qui finit par me faire dire, par concierge interposé au téléphone, que la personne féminine en charge n’est pas là aujourd’hui. Quand je commence à dire que ce n’est pas acceptable, l’on me dit qu’elle pourrait venir travailler. Quand je demande quand, l’on me dit qu’il faut attendre. Ca et là se promènent des gens dont on se demande ce qu’ils font effectivement dans ce building, tout le monde ayant singulièrement l’air désœuvré. C’est révélateur d’une administration pléthorique et inutile.
La « mission » qui figure en lettres capitales sur le mur face à l’entrée et qui prétend que l’intérêt des utilisateurs est au cœur de leurs préoccupations parait fort éloignée du concret. Je pique la mouche et claque la porte. Je vais vider mes machines qui n’ont pas du fonctionner récemment et je vais retrouver Victor, ayant obtenu, en cours de pérégrinations, d’un local, l’adresse d’un laudromat dans les suburbs de la capitale.
Victor, après une visite infructueuse chez le shipchandler, (c’est une autre histoire dont je vous ferai grâce) me pousse dans sa voiture dans un quartier assez périphérique. Il me laisse entendre qu’il ne sera pas facile d’en revenir. Je le sais déjà, mais je sais que Fabienne n’apprécierait pas un looser qui reviendrait la mine dépitée avec le linge sale.
Je pousse la porte d’une entreprise d’un autre âge. Une femme de couleur à la corpulence indiscutable m’interpelle, du ton de celle qui voit pour la première un touriste blanc débarquer dans son laudromat.
S’ensuit une discusssion en anglais créole où je regarde et essaie de comprendre ce que l’on me demande, parfois avec insistance. Je finis par répartir le contenu de mes deux sacs entre couleur et blanc. Et avec l’accord de la toute puissance de ces lieux, je suis autorisé à remplir deux énormes machines.
Je finis par comprendre que le lavage suivi du séchage prendra environ une heure. Je décide de prendre le large pour aller siroter un café. Mais les trois lieux ouverts proches n’ont ni table, ni chaise pour le client. Vu la Covid, tout n’est accessible qu’en delivery.
Je finis par trouver un coin dans une boulangerie, merveilleusement rafraîchie à l’air conditionné, dans le coin de laquelle, debout, je peux m’occuper avec mon smartphone, récemment doté d’une carte locale, qui me permet de surfer et d’appeler en WhatsApp à moindre prix.
Je retourne dans la laundry, pour constater que rien n’est fini, le blanc ayant nécessité plus de temps.
Je trouve un coin pour m’asseoir et m’assoupis. Je me réveille en sursaut, car les carrelages du sol et les murs se baladent sous mes yeux ahuris. Je suis pris d’un crise aiguë de mal de terre. Je vois les murs s’écraser les uns aux autres et je retrouve le rythme et la séquence des vagues qui s’entrechoquaient sous et autour du catamaran.
Je me lève, je titube. La patronne se demande si je suis sous produit. Fort heureusement, le séchage vient de prendre fin. Et mon vertige disparaît.
Je me retrouve devant une planche très usagée ou des générations de personnes peu favorisées de la Barbade ont trié leur linge devenu propre. Et dans une chaleur qui dépasse les 40 degrés, je trie et je plie tous les vêtements et draps, housses et sous vêtements qui sentent le propre et qui sont bouillants…
Vient alors la question sournoise de la voix intérieure. Penses tu avoir réussi ta vie, pour ne pas avoir été là chaque semaine à trier et plier ton linge. As-tu réussi pour autant ? Pour quel motif te retrouves-tu à 62 ans à crever de soif dans cette chaleur étouffante à accomplir cette tâche peu gratifiante ?
Je n’ai que le temps de payer une somme relativement modeste, pour me retrouver à l’arrêt de bus en plein soleil, à midi, à côté d’un homme de couleur goguenard, qui me marque le fait que je n’ai rien à faire à cet endroit. Je finis par comprendre que le bus passe « régulièrement ». Mais pas plus. S‘il arrive dans trente minutes, il faudra aller me chercher à l’hôpital. Une sirène stridente me tire d’une forme d’assoupissement. C’est un minibus taxi collectif qui passe, sur le mode « je précède le bus et lui pique tous ses clients ».
Je suis littéralement happé par l’homme de la portes coulissante du taxi qui me charge avec mes sacs. Je me retrouve assis sur une rangée entre des personnes de la banlieue. Le conducteur me regarde amusé. Ses yeux sont injectés de sang et je le devine sous l’emprise d’un paquet de diverses substances. Ce Fangio ne tarde pas à démarrer sur les chapeaux de roue est je parcours en quinze minutes un chemin que j’aurais, au volant, mis personnellement trente minutes à accomplir.
Vive la vie, pensé-je alors. Jamais à Genève autour de la rue des Alpes ou de mon ancien domicile, ai-je vécu aussi intensément et proche de la mort. Mais m’être extirpé de ce confort et de cette routine helvétique est-il le signe d’une forme de réussite ou simplement d’un anti-conformisme que j’ai vissé au corps ? Au lecteur de trancher.
Je retrouve Lionel venu me chercher en dinghy qui me ramène au bateau à l’ancre dans la baie, d’où je suis parti presque 5 heures plus tôt. J’ai de la peine à expliquer à ma famille par quels états physiques et d’âme je suis passé.
Peu importe, aux yeux de ma femme à qui je ramène une lessive parfaitement propre et encore chaude, je suis redevenu le demi-héros que j’étais au moment du mariage, statut que trente ans de vie commune ont sans doute dû mettre en péril.
Entre la traversée de l’Atlantique et la mission lessive réussie, je regagne clairement des places au classement. N’est-ce pas là en définitive la réussite vers laquelle tendre ? Celle qui permet de continuer de regarder le regard de son épouse pour y guetter davantage d’admiration que de déception….
Affaire à suivre. Au prochain lavoir public. Vous y serez toujours les bienvenus.

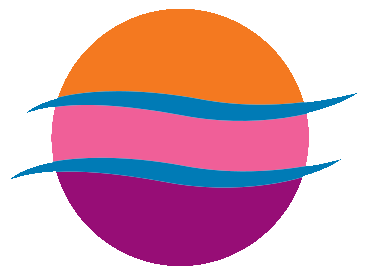 ur
ur