Crazy Frayeur : scribō ergo sum
Écrit par Vincent le 01/06/2022

Je vous raconte mon vécu de cet accident. Pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que quand je l’ai vécu je me suis juré, si je m’en sortais, de restituer par écrit certaines scènes, certains ressentis.
Ensuite, parce que je crois que cela peut avoir un côté didactique. Notamment du côté des navigateurs.
Enfin, et peut-être surtout, parce que cette écriture a comme pour Fabienne un effet libérateur, voire guérisseur. J’écris, donc je vis. Scribō ergo sum, en quelque sorte.
Ceux que la lecture de cette épisode a déjà traumatisé ( merci à tous de vos témoignages nombreux) pourront fort bien faire l’économie de prendre connaissance de ce qui suit et ne garder en mémoire que ce que Fabienne a déjà si émotionnellement et si parfaitement narré.
Nous sommes dans la partie NW de l’atoll d’Apataki, à proximité de la deuxième passe.
Nous avons mouillé par environ 15 mètres de fond. L’eau est limpide, mais pas au point de voir si notre ancre sera libre le lendemain tôt, lorsqu’il faudra partir pour prendre le courant dans le bon sens et rentrer dans la passe pour sortir de ce bel atoll.
Pierre avant le repas de midi est revenu l’air pessimiste. Selon son constat, notre ancre est crochée sous un massif de corail. Ce sera impossible de la relever. Il faut aller la décrocher dès que possible, avec une bouteille de plongée.
L’avant-veille, la même mésaventure était arrivée à Impossible à l’anse Amiot. J’avais dû enfiler mon équipement de plongée et libérer la chaîne de leur ancre, coincée à plusieurs endroits dans les coraux. J’en étais revenu avec une bouteille pleine à 150, soit les trois quarts de sa contenance.
C’est donc en connaissance de cause, que je décide de choisir la même bouteille. Je me dis qu’en 10 minutes maximum, ce sera chose faite et que j’ai donc bien assez d’air comprimé avec moi.
Pierre me suit avec son masque et son tuba. Il prend aussi des pare battages et des cordes. L’idée est de suspendre la chaîne au dessus du massif de corail grâce aux pare battages.
Je descends progressivement. Je suis la chaîne dans le sable. Et je découvre que celle-ci remonte jusqu’à un massif de corail de 10 à 15 mètres de long. Ce massif est composé de deux tours principales de plus de deux mètres au dessus du fond. La chaîne passe entre ces deux tours. Elle est coincée à plusieurs endroits. Je traverse ce massif et découvre l’ancre littéralement enchâssée de l’autre côté avec une chaîne enroulée autour de plusieurs patates.
Quelle guigne. Si l’on avait mouillé 12 mètres plus loin, ce n’aurait été que du sable.
L’idée me traverse alors l’esprit de simplement porter l’ancre et la chaîne 12 mètres plus loin, ce qui devrait résoudre tous les problèmes.
Au moment de procéder je suis approché par un poisson pilote de 50 cm. Ce sont des poissons qui se collent aux requins avec leur tête plate en forme de ventouse.
Il parait intrigué par ma présence, m’approche avec des yeux doux. Et reste proche de moi, comme s’il attendait que je le caresse.
Mais je pars déjà dans ma tâche herculéenne. Je soulève l’ancre qui pèse 25 kilos. Et j’essaye de lui faire franchir l’obstacle de corail. Je parviens péniblement à la transporter sur cinq mètres avant que la chaîne ne me bloque. Je dois poser l’ancre, retourner en arrière et libérer la chaîne, puis porter cette chaîne devant l’ancre. C’est plusieurs fois de suite que je procède ainsi, au prix d’un effort colossal. J’y suis complètement investi. À chaque fois, je me dis que j’y suis presque.
Après moult efforts, toujours en présence du poisson pilote, et alors que je perds parfois toute visibilité dans les nuages de sable, j’arrive à poser l’ancre dans le sable.
Victoire. Je me sens héroïque...
Je regarde la chaîne graduellement se tendre sur le sable et je me dis que j’ai réussi. Et il n’y aura même pas besoin de suspendre des pare-battages.
Je me demande alors si j’ai encore un peu de temps pour voir alentour d’autres massifs, maintenant que je suis là. Je regarde mon compteur. Il indique zéro. Au même moment, j’aspire et rien ne vient.
Je cherche à ne pas paniquer. Mais je dois immédiatement réagir.
Je commence à remonter en me rappelant que je dois vider mes poumons en remontant. Mais lorsque la surface arrive, je dois avoir un réflexe de ne plus expirer, car je sens une douleur dans la poitrine. Je parviens cependant à faire surface juste à côté de Pierre, qui nage avec ses deux pare battages.
Je dis à Pierre que j’ai eu un accident. Je lui demande de me ramener. Je vois Fabienne sur le trampoline et lui dis du bout des lèvres « accident ». Je vois Fabienne qui court de l’autre côté du bateau et appelle Sébastien sur Impossible.
J’arrive au pied de l’échelle sur la coque tribord, remorqué par Pierre. Il m’est impossible de monter avec tout ce que j’ai sur le dos et mes palmes. Je me sens aussi progressivement m’engourdir. Pierre m’enlève mes palmes. Dans un effort surhumain, j’arrive à me hisser. Je m’écroule sur le bout de la coque. J’entends que l’on s’affaire à m’enlever ma bouteille et mon équipement de plongée. Je ne peux presque plus bouger.
L’on me tire, grâce notamment à Sébastien qui vient d’arriver, sur le haut des escaliers, sur le replat de la coque tribord.
Je sens que l’on me donne un masque d’oxygène. Je le saisis et me concentre sur ma respiration.
J’entends Fabienne qui perd à ce moment-là un peu ses nerfs et les autres qui la calment.
Bizarrement, j’entends tout. Je comprends tout. Mais je ne vois plus rien. Je ne cherche ni à bouger ni à voir. Je suis en position de sécurité sur la droite. Valentine se positionne près de moi. Je lui dis que je ne sens presque plus rien. Elle a des propos apaisants qui me réconfortent. On va tout faire pour s’en sortir…
J’entends alors une voix avec un accent italien. C’est le skipper italien de Imagine B, un monocoque de 40 mètres que j’avais aperçu à 500 mètres de nous, plus à l’Ouest au mouillage. On avait déjà aperçu de loin ce monocoque à Rotoava, sur l’atoll de Fakarava. Apparemment il venait gentiment nous amener du thon récemment pêché.
Ce skipper paraît très au fait de ce qu’il faut faire et comment réagir. Il demande que l’on m’enlève ma combinaison ce qui me fait déjà du bien. Ensuite il demande que l’on me transporte et étende dans le cockpit, où je serais mieux et à l’ombre. Ce transport s’effectue avec un drap.
J’entends ensuite des échanges entre Pierre et Sébastien sur le moyen d’obtenir des secours. Avec des interventions de Fabienne. Je capte tout, mais sans m’énerver ni paniquer, ce qui serait contre-productif.
Je suis en continu pris en charge par Valentine qui s’assure que je ne perde pas connaissance. Fabienne me donne eau et aspirine. Je m’accroche au masque d’oxygène et demande à plusieurs reprises si l’on en aura assez. Le skipper italien revient de son bateau avec une autre bouteille. Je me dis que l’on a encore un peu de temps devant nous. Si je suis apparemment stabilisé, je n’en suis pas moins dans un état assez précaire.
Je commence à me dire que je vais pouvoir peut-être m’en sortir. Je ressens très progressivement moins d’engourdissement et je peux même commencer à voir autour de moi.
Après un long moment que je ne peux évaluer, je comprends que l’on va se mettre en route pour rejoindre un bateau qui vient me chercher et qui fait déjà route dans notre direction. Fabienne a préparé en toute hâte des vêtements et des papiers à emporter pour elle et moi.
Je contiens mon impatience et m’abstiens de toute réaction devant le fait que l’on mette apparemment du temps à sortir le Crazy Fabi hors de l’eau.
Miracle, l’on peut remonter l’ancre et la chaîne, grâce à mon travail de forçat sous l’eau.
Pierre se met à la barre avec Sébastien à ses côtés et l’on se dirige plein Sud, en direction du village d’Apataki.
J’entends ensuite des voix. L’on monte à bord. Une aide infirmière me prend de suite le taux de saturation. Elle exprime son soulagement. Il est à 98%, ce qui est excellent. On amène ensuite une civière, car j’explique ne pas être en mesure de marcher pour quitter le bateau.
Ce sont de forts gaillards qui m’empoignent pour passer la civière d’un bateau à l’autre, nonobstant les vagues. Je préfère fermer les yeux et me concentrer sur ma respiration.
J’ai juste le temps de voir Pierre assis au poste de barre face à un récif de corail très proche.
En quittant le bateau, je demande encore à Pierre de toujours rester à portée de VHF d’Impossible durant tout le trajet jusqu’à Tahiti. Ils devront partir le lendemain à l’aube.
La civière en aluminium sur laquelle je repose au fond du semi-rigide comporte une forme de matelas assez sommaire. Je me cale un peu sur le côté tant bien que mal. J’entends Fabienne parler avec l’aide infirmière, et cette dernière expliquer qu’il y aura deux heures de trajet. Je me dis qu’il faudra dans mon état de faiblesse généralisé savoir faire preuve d’endurance.
En effet, malgré les efforts du pilote, le bateau tape parfois dans la vague et je dois encaisser le choc sans perdre mon souffle ni mon rythme de respiration. Je remarque que je ne peux me mettre dans l’autre sens, une forte douleur me perçant la cage thoracique, dans la région du cœur. Je sens que je peux respirer. Mais pas normalement.
Je me concentre sur mon état et me demande si je vais avoir des lésions irréversibles. Je me rappelle un cas que j’avais eu à traiter comme juge suppléant de la Cour de Justice de Genève, qui est la juridiction d’appel, au sujet d’un plongeur.
Celui-ci était resté paralysé en dessous de la ceinture en raison d’une atteinte médullaire après deux plongées et d’autres incidents post plongée.
Je concentre mes neurones pour tenter de reconstituer l’état de fait de ce cas judiciaire. Je tente de me rassurer en relevant de mémoire de substantielles différences dans la chronologie et le comportement du plongeur. Je vérifie à intervalles réguliers que mes doigts et orteils répondent et bougent quand je leur en donne l’ordre. A priori, tout marche parfaitement.
C’est le moment que Fabienne choisit pour me demander si je vais bien, et quand je lui réponds que c’est moyen, elle me rappelle que si je finis dans une chaise roulante elle m’amènera en haut du Salève pour un dernier saut. Elle espère me faire réagir, en me forçant à m’accrocher. C’est de bonne guerre. Elle ne sait toutefois pas que c’est précisément l’hypothèse d’une paralysie à laquelle je pense depuis quelques minutes avec ma tentative de reconstituer l’état de fait de cette jurisprudence du plongeur…
En fait je suis serein devant un éventuel décès. Ce sentiment m’étonne moi-même. Je suis simplement zen devant l’hypothèse du grand départ. Pas de révolte. Pas de sentiment d’injustice. S’il faut partir maintenant, et bien soit. Mais pas question toutefois que je ne tente pas tout pour m’accrocher et l’éviter. Et cela ne change rien à mon rythme de respiration. Je cherche à ne pas trop gamberger. Je me concentre sur tout ce que je peux faire pour ne pas empirer mon état, voire l’améliorer.
A tour de rôle, l’aide infirmière et Fabienne viennent vérifier ma saturation et que la bouteille d’oxygène libère le précieux gaz dont tout dépend. On change de bouteille en cours de route. Je suis anxieux d’avoir assez d’oxygène jusqu’au dispensaire. L’on me rassure.
Je sens enfin que le bateau ralentit et que l’on arrive progressivement à quai. Je crois, vu la nuit tombée, que personne ne sera là. Je me trompe lourdement. Une nouvelle équipe de costauds empoignent la civière. Et me portent dans ce que je comprends être l’arrière d’un truck. Je vois toutes les étoiles dans le ciel. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est une vue incroyable. Fabienne s’assied à côté de moi. Je vois son visage répondre aux regards de la foule de gens présents et les remercier tous d’être là. Je ressens beaucoup d’émotion et de dignité.
À nouveau, je me concentre sur les cahots de la route. Je comprends que l’on m’amène au dispensaire. Huit personnes empoignent la civière et me montent d’un étage dans un escalier non prévu pour convoyer une civière.
Arrive un infirmier qui se présente : Roland. Un catogan et l’air de bénéficier d’une grande expérience. Lentement, mais méthodiquement l’accident est restitué, avec le concours de Fabienne. Il faut une bonne trentaine de minutes avant l’on décide de me donner des anti douleurs et de me mettre une perfusion. C’est sans doute juste, mais je trouve que tout cela prend trop de temps, surtout que je comprends qu’il n’y a pas de caisson ici. Et je recommence à penser au plongeur de mon arrêt qui était allé trop tard dans son caisson.
Finalement, Roland sort de la pièce pour une conversation, hors ma présence, avec le SMUR, basé à Papeete. Il revient en me disant que l’on attend la décision de ce service. Je demande si un hélico a décollé. Personne ne sait. L’attente continue sous le goutte-à-goûte et avec l’oxygène du dispensaire.
Roland reçoit devant nous un appel. L’on envoie un hélico de Papeete. Mais il faudra deux heures pour qu’il arrive. Je sens Fabienne soupirer. L’attente commence à être longue depuis l’accident.
Je vais un peu mieux. J’arrive à me mettre sur le dos. J’ai l’impression que cela devient moins douloureux. Je commence à prendre mon portable et lis mes e-mails. Je vois un e-mail de notre fille Ambre qui me demande de la rappeler. Je fais le numéro et la passe à Fabienne dont le visage se décompose. Son père est hospitalisé à Genève. Je la sens proche de craquer complètement. Surtout que l’on vient de lui dire, puis le SMUR de lui confirmer par téléphone, qu’il n’y aura pas de place pour elle dans l’hélico qui m’emmènera.
Je tente de réconforter Fabienne.
Je sens que l’activité dans le dispensaire se focalise maintenant sur elle et son devenir sur l’atoll. C’est bien qu’elle soit prise en charge, me dis-je, c’est même crucial que je ne parte pas avec cette incertitude sur son sort.
Elle est aussi en contact avec Luc du GLYWO, mais à distance celui-ci ne peut guère intervenir. J’entends qu’il la rassure sur mon état, fort de son expérience de plongeur émérite comptant plusieurs milliers de plongée.
Je dis aussi à Fabienne ma préoccupation que les bouteilles d’oxygène de Impossible et de Imagine B soient conservées puis restituées. Elle a des échanges à ce sujet avec Luc qui alertera ensuite les bateaux participant au GLYWO pour que l’un d’eux qui se rendrait à Apataki prenne livraison de la bouteille vide appartenant à Impossible... Fabienne commence des démarches pour l’autre bouteille.
J’entends le bruit de l’hélico, puis plus rien. J’ai dû avoir une hallucination auditive
Non, je l’entends à nouveau. Il a dû faire une approche en deux temps.
Psychologiquement, je vais déjà mieux. La cavalerie arrive enfin.
La porte s’ouvre sur deux jeunes hommes portant des sacs. Un médecin d’urgence et un infirmier. Gabriel et Bertrand.
Je re-explique tout. En détail. Je me prête à un examen complet. Le docteur arrive rapidement à la conclusion d’un pneumothorax. J’avoue ne pas savoir ce que c’est. Il explique : l’air qui s’échappe du poumon sous la trop forte pression, se réfugie alentour ce qui fait que le poumon gauche se réduit et ne fonctionne plus. Je comprends que je respire sur un poumon, que mon cœur se bat plus vite pour compenser et qu’il faut éviter que cela ne se prolonge.
Je comprends aussi à ce moment précis que si le poumon droit avait connu le même sort que le gauche, j’aurais cessé de vivre, ce que Gabriel O’Connor me confirme. Je réalise progressivement la gravité de mon état et ma chance d’avoir tenu jusqu’ici.
Gabriel m’indique que l’on n’a pas le choix. Il faut me placer un drain entre les côtes sur mon flanc gauche. De toutes façons je ne suis pas transportable en l’état. J’acquiesce. Il demande à Fabienne de sortir de la pièce. Elle est blême.
Une telle intervention en dispensaire est inusuelle. Elle est de surcroît assez douloureuse nonobstant l’anesthésie locale.
Je sens la mécanique de l’intervention se mettre en marche. Très bien huilée. On sent les professionnels à l’œuvre dans la préparation du champ stérile, de la désinfection de mes côtes et de la préparation du tout. Bertrand a des gestes d’une efficacité et d’une précision fantastiques. Ils se parlent peu et agissent rapidement en parfaite symbiose.
Je demande à Roland qui m’avoue ses trente ans d’expérience s’il a déjà vu une telle intervention dans l’un de ses dispensaires. Il me dit : oui, une fois. Je ne suis guère rassuré.
L’on me prépare de la morphine que l’on m’injecte. Je sens mon cœur qui se serre assez violemment, puis quelque chose qui s’introduit, mais à peine.
Le drain est placé et l’urgentiste peut rééquilibrer mon poumon sans pour autant mettre en route la pompe pour drainer celui-ci.
S’ensuit un téléphone avec l’un de ses collègues. Doit-on commencer à drainer maintenant ou attendre l’hôpital ? Contre l’avis de son collègue, O’Connor décide de ne pas drainer. Il ne sait pas si sa mini-mallette qui contient la pompe de drainage fonctionnera pendant toute la durée du vol, explique que l’hélico ne pourra pas se poser en cas de complication, et qu’il ne se voit pas re-intervenir efficacement en vol. Il estime que le poumon va déjà mieux depuis qu’il a pu poser le drain. La suite attendra.
J’apprécie cet échange intervenu sur le haut-parleur de son portable devant moi. J’ai confiance dans le Dr O’Connor et me sens déjà tellement mieux, que je ne vois pas l’intérêt d’une prise de risque supplémentaire.
L’on comprend ensuite qu’il faut y aller assez vite. Car je suis passé sur la bouteille d’oxygène de l’hélico qui a une capacité limitée. L’on volera à 100 pieds sol pour éviter tout problème à mon poumon et vu le risque de bulles résiduelles dans mon organisme, même si a priori, l’on semble écarter ce risque. Tout comme un passage dans le caisson.
Je prends congé de Fabienne que je sens très émue. Je tente de la réconforter. Mais se retrouver seule sur cet atoll en me voyant partir est pour elle une nouvelle épreuve traumatique. Je ne peux hélas rien faire. Je lui explique qu’elle aura les ressources et que l’on a heureusement les moyens techniques de rester étroitement en contact.
Il est très tard, mais je découvre que des porteurs de civière sont à nouveau là. Il sont six qui vont redescendre les escaliers et m’amener directement devant, puis dans l’hélicoptère de la Marine française. Le Dr O’Connor me montre qu’il n’y a effectivement pas d’espace possible pour prendre Fabienne. Je suis allongé sur le dos sur la civière avec les pieds sur l’arrière du fauteuil du pilote. Il y a un co-pilote devant et un sous officier assis à droite de mes pieds. Viennent s’asseoir sur leurs fesses le médecin et l’infirmier à mes côtés. J’ai une pensée qui me traverse relative aux évacuations de blessés de la guerre du Vietnam en hélicoptère. Les conditions ne me semblent guère avoir changé.
Juste avant de décoller l’on décide de me réinjecter de la morphine pour que je tienne bien le temps de la durée du trajet, alors que je sens sous moi les forts tremblements de la structure de l’hélico.
Je sens dès le décollage une douleur au poumon que je décide de combattre par l’auto-hypnose. J’élimine toute pensée négative. Je revois mon poisson blanc aux yeux si doux…. Je crois que j’ai réussi à m’assoupir alors que l’on arrive sur le toit de l’hôpital à 2h45 du matin.
Je remercie vivement le pilote et ses acolytes. Je lui demande combien l’on a consommé. Il me répond environ 500 litres. Je me dis que, pour quelqu’un qui appelait dans un précédent article de ce blog à la frugalité énergétique, c’est décidément beaucoup.
Je suis transporté en salle d’urgence. L’on me fait une radio. Puis l’on me met en marche la pompe reliée au drain. C’est de nouveau assez douloureux au niveau du cœur et j’ai droit à une troisième injection de morphine. L’on me sortira progressivement 0.4 litres de liquide/sang par ce drain.
Je comprends que des échanges téléphoniques interviennent entre Gabriel et le spécialiste hyperbare, que l’on a réveillé à 4h00 du matin. Après ces échanges, l’on me confirme qu’en l’état je n’irai pas dans le caisson. Ce spécialiste me rendra visite dans ma chambre à la première heure.
Puis, je suis emmené dans une chambre au département des urgences. J’ai juste le temps de remercier mes sauveurs, Gabriel et Bertrand. Gabriel m’indique qu’il a écrit un WhatsApp à Fabienne, pour l’assurer que tout était sous contrôle.
Je me dis dans le silence de ma chambre faiblement éclairée que je suis sauvé. Et que j’ai bénéficié d’un concours de solidarités exceptionnel. J’en ai maintenant la conviction, je vais survivre. Il va falloir désormais me battre pour que tout évolue dans la bonne direction, rétablir le lien avec Fabienne et les deux bateaux bientôt en route, et informer graduellement, tout en rassurant, sur mon état de santé.
Je réfléchis à ce qui importe en priorité. C’est mon I-phone.
J’obtiens de suite que l’on me prête au sein du service des urgences une rallonge d’I-phone. La suite dépendra essentiellement de ce que je puisse atteindre et être atteint, ce qui suppose une batterie pleine en permanence. Et je réfléchis pour mieux anticiper sur tout ce qui m’attend.
Cela fait, je dors quelques minutes, pour être d’attaque dès l’aube. Et je retrouve mon poisson blanc au yeux doux….C’est comme si je comprenais a posteriori qu’il avait tenté de me prévenir.
La suite et fin de mon hospitalisation à l’hôpital de Taaone, à Papeete fera l’objet d’un bref prochain article. Tout comme le vécu de Fabienne se retrouvant seule sur l’atoll d’Apataki, sur lequel des relations humaines extraordinaires vont se nouer.

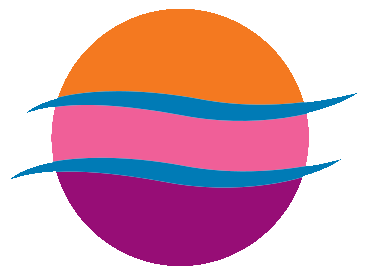 ur
ur